À propos
Manifeste
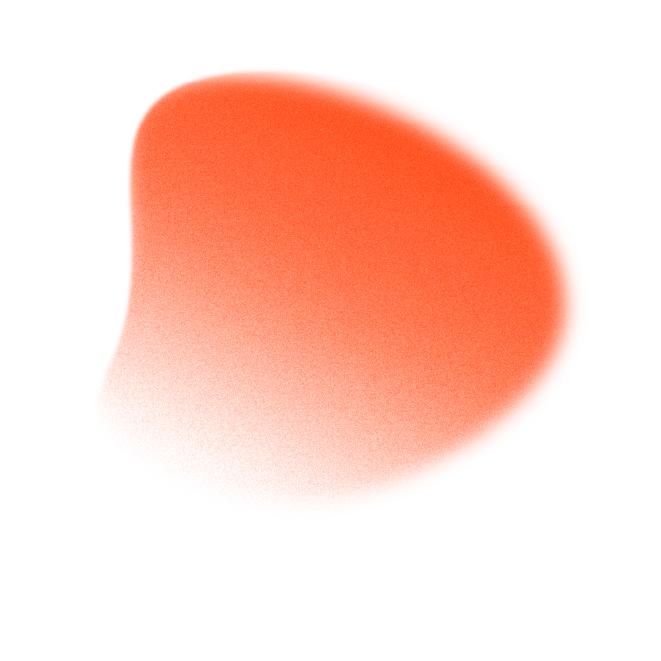
Nous croyons à la démocratie.
Pour décider à plusieurs, il faut organiser le pouvoir. Nous affirmons qu’il ne doit pas s’agir de désigner des chef·fes, mais d’analyser collectivement nos intérêts parfois singuliers et contradictoires.
Nous visons une réappropriation franche et profonde du politique par tous et toutes.
Parce que nous pensons que faire démocratie n’est pas quelque chose d’inné, nous exprimons l’importance d’expérimenter et de s’outiller. La démocratie n’est pas un état mais une pratique qui requiert un exercice quotidien.
Cela doit être un travail permanent. Toujours plus de démocratie !
Nous souhaitons un maximum de conflits.
Animer les conflits c’est mettre en lumière les dominations et contradictions. Créer du rapport de force est une condition à l’expérience de la démocratie. En situation de domination, nous souhaitons pouvoir envisager de rentrer en conflit comme stratégie d’action.
Nous ne sommes qu’à la marge la source de nos problèmes, qui sont politiques, c’est-à-dire structurels, qui concernent tout le monde.
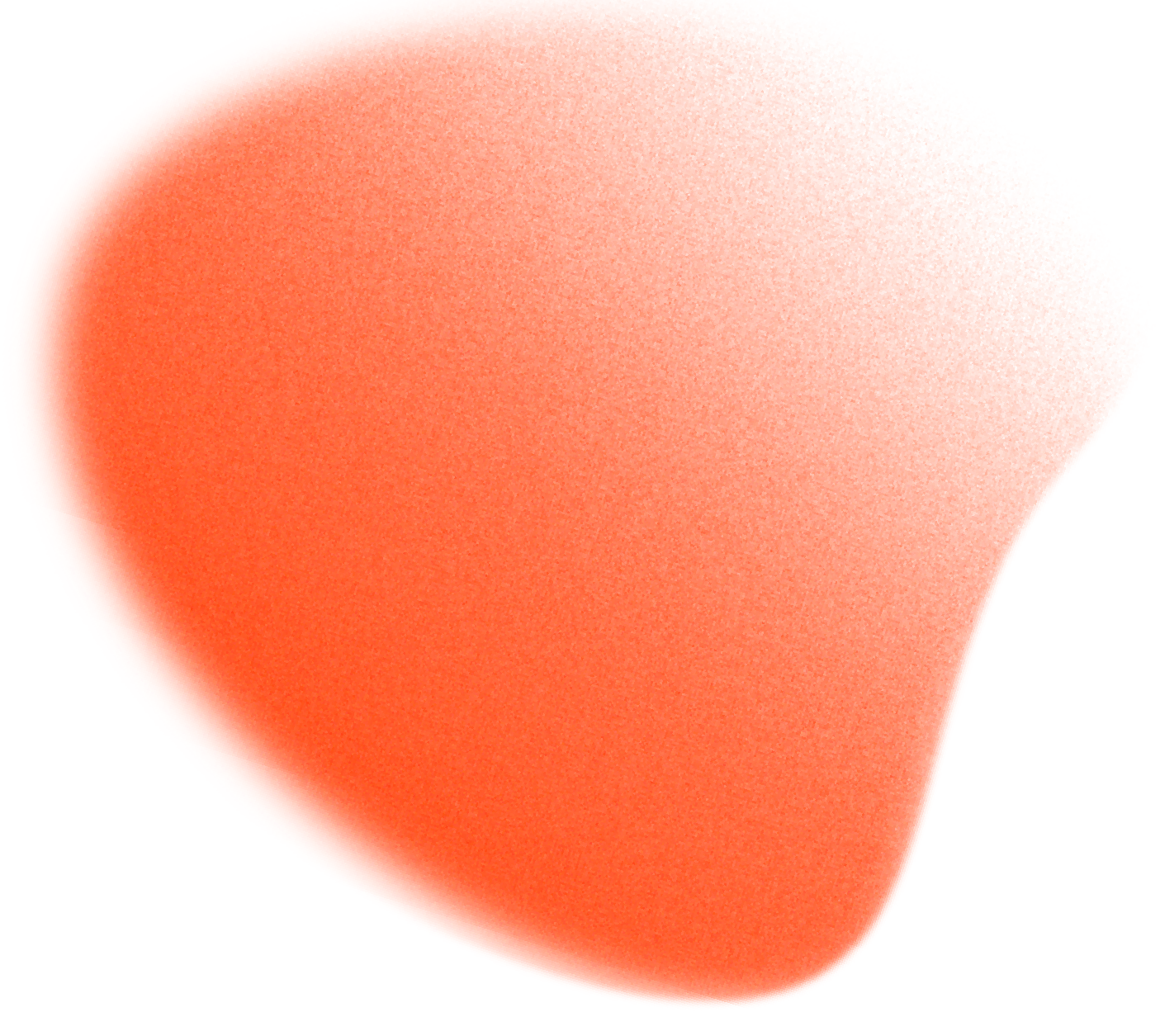

Nous ne croyons pas au mérite,
mais plutôt aux rapports sociaux (de classe, de genre, de culture d’origine…) qui structurent la société et nous déterminent. Nous voulons nous émanciper, prendre conscience des places qui nous ont été assignées et considérer l’idée que ce qui nous semblait impossible ne l’est finalement pas. Les dominations doivent être mises au travail, par les opprimé·es comme par les dominant·es.
Il est nécessaire d’agir collectivement
pour exister et peser sur les prises de décisions qui nous concernent. Le collectif donne une richesse dans les réponses que l’on construit et une puissance dans les actions que l’on mène. Ce n’est pas toujours simple, mais la défense collective de causes ne doit pas se faire au détriment des individus. Nous pensons qu’il est vital de prendre en compte les personnes, leurs ressentis et leurs besoins.

Mettre des mots sur des sentiments d’injustice et s’atteler à en comprendre les causes encourage l’insoumission.
Nous ne sommes pas neutres.
Il est nécessaire de reconnaître et de nommer l’idéologie dominante, celle en dehors de laquelle nous ne parvenons bien souvent pas à raisonner. Nous ne nous pensons pas condamné·es à vivre dans une société capitaliste, néolibérale et managériale. Soyons subversifs et ne jouons pas au jeu auquel on n’a pas envie de jouer ! Refusons la performance, les résultats évaluables, la compétition. Des alternatives sont possibles. Nous revendiquons le droit de rêver, de laisser une place à la poésie face au tout rationnel.

Nous acceptons le fait que c’est compliqué.
N’arrêtons jamais de nous requestionner et de solliciter les regards extérieurs, pour réajuster nos manières de faire. Pour agir, il faut prendre en compte toute la complexité du réel. En prenant le temps de déplier et d’analyser l’ensemble des facettes d’une situation, nous multiplions les pistes d’actions concrètes.
Le figé est mortifère.
Nous ne voulons pas le pouvoir,
nous voulons pouvoir.
Nous prônons l’action et l’expérimentation. Nous n’avons pas de plan et savons qu’on ne peut pas tout prévoir. Nous pensons qu’il faut s’autoriser à poser des actes, puis penser et analyser ce qu’ils provoquent, empêchent et inspirent. Nous avons le droit de nous tromper, de recommencer, de tenter sans être sûr·es de nous. Nous sommes tous et toutes faillibles, et c’est tant mieux.
Travailler, c’est faire l’expérience de ce qui résiste.

Nous croyons en la puissance du récit de vie.
Se raconter collectivement nos vécus, nos expériences, nos ressentis et nos émotions, permet d’élargir et de déconstruire notre vision du monde. Mises en commun, elles sont autant de moteurs pour l’action.
Nous choisissons la forme coopérative comme outil concret pour vivre et faire vivre toutes ces intentions.

Nous tenons à ce que les personnes qui travaillent soient celles qui décident. Nous travaillons à nous offrir des conditions d’emploi intéressantes, laissant place au temps libéré pour d’autres activités et nos vies de famille.
Nous voulons décider des intentions politiques
que nous servons à travers nos actions. Le développement de l’activité n’est pas une fin en soi. Ne pas chercher à toujours produire davantage permet d’interroger chaque proposition à l’aune de nos convictions.
Nous savons que nous ne sommes pas seul·es.
Nous avons vraiment l’intention de faire réseau. Il s’agit d’additionner des actes qui se nourrissent, de promouvoir ce qui ne nous ressemble pas forcément mais qui participe à une transformation sociale.
Nous souhaitons travailler en proximité et dans la durée, nous visons d’agir collectivement sur des problématiques communes, nous voulons prioriser des stratégies d’alliances entre structures plutôt que de mise en concurrence.
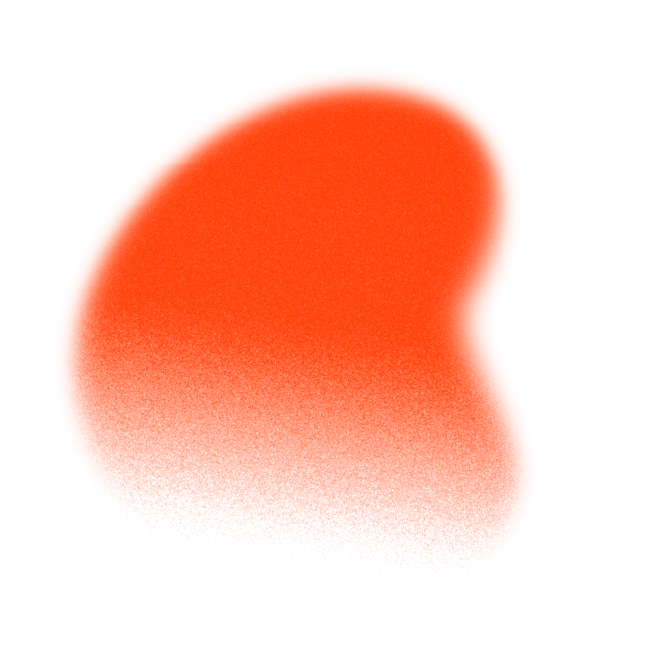
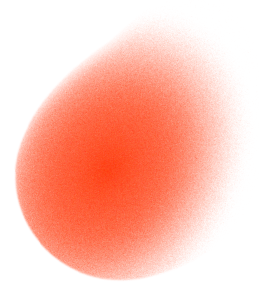
Nous déclinons notre action sous plusieurs formes






